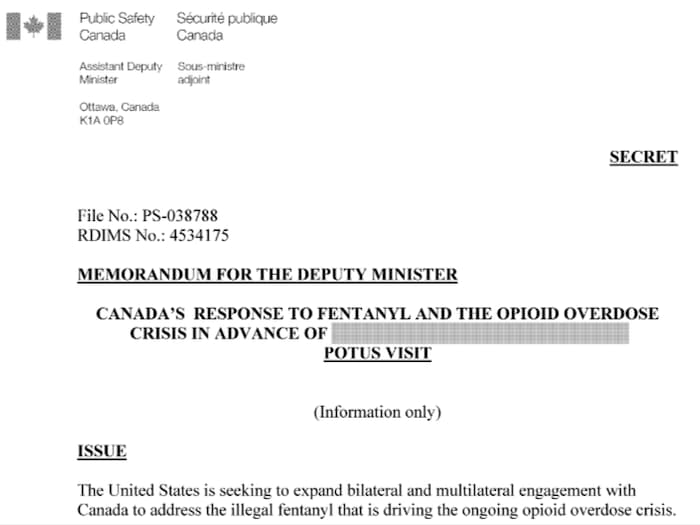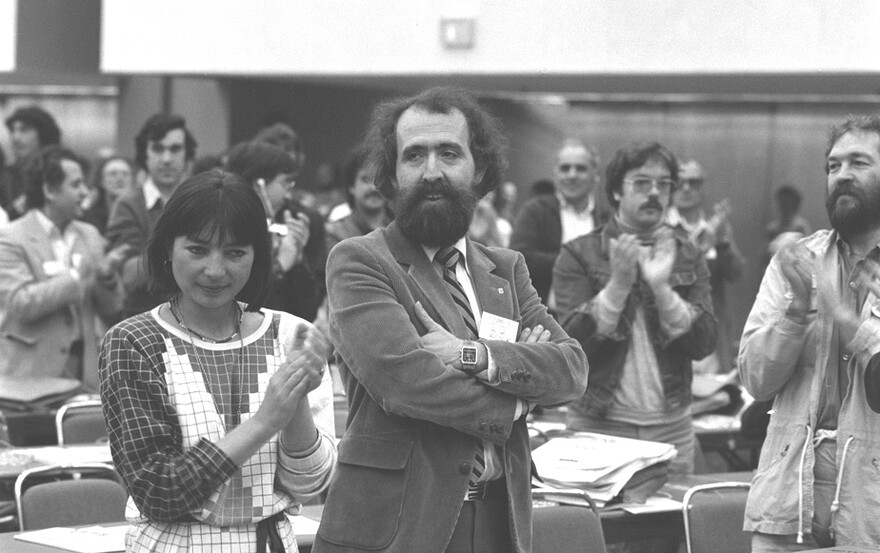Fermer la porte à l’esclavage
PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE
Un certain nombre de travailleurs étrangers temporaires au Canada disposent d’un permis de travail fermé, qui les lie à un seul employeur.

Rima Elkouri La Presse
On aimerait bien croire que l’esclavage est un vestige du passé au Canada. Une injustice tout juste bonne pour les livres d’histoire et les journées commémoratives où l’on répète « plus jamais ».
Publié à 2h04 Mis à jour à 5h00

Le rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage est venu récemment ébranler nos belles illusions. Les travailleurs étrangers temporaires au Canada ayant des permis de travail fermés, les liant à un seul employeur, risquent d’être soumis à une forme d’esclavage moderne, a constaté Tomoya Obokata, expert onusien du droit international et des droits de la personne, qui a produit un rapport dévastateur sur la question1.
Quand il parle d’« esclavage moderne », le rapporteur spécial de l’ONU fait référence à la forme la plus grave d’exploitation et de contrôle exercée sur des travailleurs. Celle qui survient lorsque des êtres humains sont traités comme s’ils étaient la propriété de leur employeur.
Profondément troublé par les récits d’exploitation et de mauvais traitements des migrants qu’il a rencontrés dans plusieurs provinces, dont le Québec, le rapporteur spécial a exhorté le Canada à en faire davantage pour protéger les droits des travailleurs étrangers temporaires.
Si certains sont surpris que l’on parle d’esclavage dans un pays démocratique comme le Canada, ceux qui l’ont vécu ne le sont pas du tout.
Parlez-en à Benedicte Carole Ze, Québécoise d’origine camerounaise qui fait partie des travailleurs ayant rencontré le rapporteur spécial des Nations unies. Bien avant que l’ONU s’en mêle, Benedicte n’hésitait pas elle-même à parler d’« esclavagisme moderne » pour qualifier la situation de vulnérabilité extrême dans laquelle l’a maintenue l’entrepreneur agricole québécois qui l’a fait venir ici en 2016 avec un permis fermé2.
Concrètement, ça veut dire quoi, Benedicte ?
Ça veut dire ne pas avoir les mêmes droits que les autres travailleurs. Être à la merci d’un employeur qui, s’il n’est pas de bonne foi, peut faire de vous ce qu’il veut.
PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE
Arrivée au Canada comme travailleuse étrangère temporaire titulaire d’un permis fermé, Benedicte Carole Ze a eu le sentiment d’être traitée comme une esclave moderne.
Que la vie d’un être humain appartienne à un autre être humain, qui peut décider si vous avez le droit de rester au pays, de travailler, d’être payé ou de vivre normalement, pour moi, c’est de l’esclavage.
Benedicte Carole Ze
Pour Benedicte, au quotidien, cela voulait dire : être forcée de travailler sept jours sur sept ; être forcée de multiplier les heures de travail non payées ; n’avoir pratiquement aucun jour de congé pendant deux ans ; être tenue dans l’ignorance de ses droits ; être isolée du monde extérieur ; se voir menacée d’être renvoyée dans son pays si elle n’obéissait pas à son patron ; vivre avec la peur au ventre…
« Et moi, encore, je m’exprime en français. Imaginez une personne qui ne parle pas français… »
Benedicte, qui, après avoir fui son employeur, a réussi à s’en sortir grâce au programme de régularisation des « anges gardiens » durant la pandémie, se bat aujourd’hui aux côtés d’autres travailleurs migrants pour que plus personne n’ait à vivre ce qu’elle a vécu.
« Nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains au Canada ! », me dit Gabriel Allahdua, qui, comme Benedicte, est membre de l’Association pour les droits des travailleuses.rs de maison et de ferme ayant déposé en septembre dernier une demande d’action collective pour qu’Ottawa abolisse les permis de travail fermés3.
Originaire de Sainte-Lucie, Gabriel est arrivé au pays en janvier 2012 pour travailler dans une ferme ontarienne, après que l’ouragan Tomas a dévasté son île natale. Lui-même héritier du colonialisme et de l’esclavage – sa mère est une descendante d’esclaves africains envoyés dans les Caraïbes –, l’homme a eu tout un choc en constatant que l’histoire se répétait en quelque sorte pour lui, alors qu’il devenait la propriété d’une ferme dans un pays qu’il avait idéalisé.

PHOTO FOURNIE PAR GABRIEL ALLAHDUA
Gabriel Allahdua est le premier travailleur migrant agricole au Canada à publier son autobiographie.
Je ne suis pas surpris par le rapport de l’expert de l’ONU. Ce qui est surprenant, en revanche, c’est que les Canadiens soient aussi déconnectés de cette réalité.
Gabriel Allahdua
Les travailleurs migrants dans le secteur de l’agriculture et de la transformation des aliments sont ceux qui sont les plus exposés aux risques d’esclavage moderne et de travail forcé. Mais les citoyens ne réalisent pas le coût humain de leur assiette, constate-t-il.
Le fait que les travailleurs migrants soient le plus souvent invisibles et condamnés au silence nourrit une certaine indifférence à leur égard. C’est la raison pour laquelle Gabriel, encouragé par le professeur d’histoire de l’Université McGill Edward Dunsworth, a brisé ce silence en devenant le premier travailleur agricole au Canada à publier son autobiographie4.
« Je suis un esclave comme les ancêtres de ma mère, exploité pour mon travail, loin de chez moi », lit-on dès les premières lignes de son livre.
Spécialiste de l’histoire des migrations et du travail au Canada, Edward Dunsworth rappelle que le racisme était, à l’origine, un des fondements du Programme des travailleurs agricoles saisonniers, lancé en 1966 comme un projet pilote pour faire venir de la main-d’œuvre jamaïcaine en Ontario.
Alors qu’à la même époque, on acceptait volontiers de recruter comme immigrants permanents des fermiers blancs de Grande-Bretagne, les autorités canadiennes craignaient que des travailleurs de ferme noirs des Caraïbes s’implantent au pays de façon permanente. D’où la création d’un programme saisonnier faisant d’eux des travailleurs temporaires… en permanence.
Aujourd’hui, observe l’historien, une discrimination fondée sur la classe sociale détermine le sort de ceux que l’on considère comme étant assez bons pour travailler, mais pas assez bons pour rester. « L’immigration permanente est généralement pour des gens de classes sociales élevées qui font des emplois ‟plus qualifiés” alors que les immigrants ‟peu qualifiés” en agriculture ou en alimentation sont de plus en plus bloqués dans des programmes temporaires. »
Si les employeurs abusifs sont à blâmer, les gouvernements successifs qui, sous la pression du lobby patronal, ont ouvert de plus en plus grand la porte au travail jetable de migrants tout en fermant les yeux sur les violations des droits de la personne qu’ils endurent le sont encore davantage.
Cela fait des décennies que des voix s’élèvent pour dénoncer la situation. Cela fait des décennies que des chercheurs documentent la question et que des comités font des recommandations qui finissent sur une tablette.
Pour éviter toute forme d’esclavage moderne, le rapporteur spécial de l’ONU recommande à son tour à Ottawa de simplifier l’accès aux permis de travail ouverts et de créer des voies vers la résidence permanente pour tous les travailleurs migrants, sans distinction.
« Dans un pays qui s’enorgueillit de sa diversité et de son multiculturalisme et se targue d’être un champion des droits de la personne, est-il juste de refuser ainsi des droits fondamentaux aux travailleurs migrants ? », demande Gabriel.
La réponse va de soi. Pourquoi le gouvernement canadien continue-t-il de tolérer l’intolérable ?
1. Lisez l’article « Un danger d’esclavage moderne, s’alarme un représentant de l’ONU »
2. Lisez un texte sur l’histoire de Benedicte Carole Ze
Voyez le documentaire Essentiels, dont Benedicte est l’une des protagonistes
3. Lisez l’article « Demande d’action collective pour abolir les permis fermés des travailleurs temporaires »
4. Lisez sur le livre de Gabriel Allahdua Harvesting Freedom (en anglais)
Abolir les permis fermés ?
Bien que le gouvernement fédéral dise « prendre au sérieux la sécurité et la dignité des travailleurs étrangers », rien n’indique qu’il entend abolir les permis fermés et leur faciliter l’accès à la résidence permanente.
Questionné à ce sujet, le cabinet du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, a envoyé une réponse par courriel disant que « toute personne mérite un milieu de travail sécuritaire où ses droits sont respectés ».
Des changements ont été faits en ce sens, précise-t-on. « Depuis juin 2019, un travailleur étranger titulaire d’un permis de travail propre à un employeur peut demander un permis de travail ouvert s’il est maltraité par son employeur actuel. Le permis de travail ouvert leur permet de sortir rapidement de ces situations et de chercher de nouveaux emplois auprès d’un autre employeur. »
Pour Eugénie Depatie-Pelletier, directrice générale de l’Association pour les droits des travailleuses.rs de maison et de ferme, ces changements sont insuffisants pour garantir le respect des droits fondamentaux de l’ensemble des travailleurs temporaires.
« Nous ne sommes pas impressionnés par les mesures mises en place pour minimiser les abus. Cela continue à maintenir un contexte de peur et d’omerta, car le statut légal du travailleur demeure dépendant de l’employeur. »