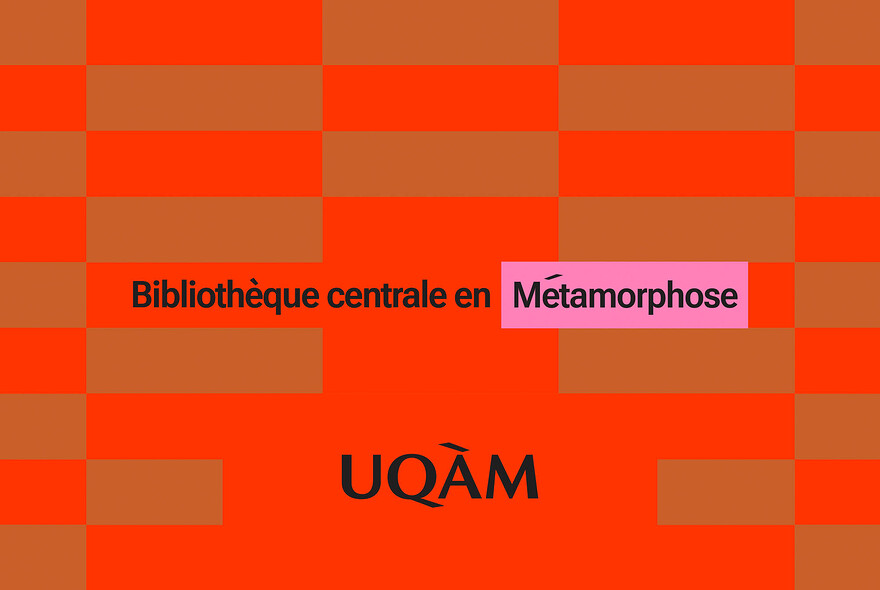Les dégâts sont déjà fait. On verra pendant combien de temps les bourses pourront être maintenu et si les fonds redirigés aux UQ seront aux niveaux espérés, surtout que le gouvernement n’augmente aucunement le financement.
Des universités dans le rouge, des choix qui soulèvent des inquiétudes
Photo: Marie-France Coallier, archives Le Devoir
Les universités du Québec souffrent d’importants manques à gagner, lesquels mènent à des décisions controversées.
Zacharie Goudreault
19 janvier 2024
Éducation
Au moment où les universités du Québec évaluent leurs besoins financiers à des centaines de millions de dollars, un frein dans les embauches, le recours accru aux cours entièrement à distance et l’alourdissement de la charge de travail sont quelques-unes des questions qui préoccupent plusieurs professeurs et chargés de cours joints par Le Devoir.
Les défis financiers des universités québécoises sont majeurs. C’est notamment le cas de l’Université Concordia, qui évalue actuellement son manque à gagner à 35 millions de dollars, contre 14,3 millions il y a à peine deux ans. Une situation qui est principalement attribuable à la baisse des inscriptions, car l’université tire 87 % de ses revenus des droits de scolarité et des subventions gouvernementales connexes. En 2019, ce déficit était de 8,9 millions.
Dans ce contexte, l’établissement anglophone a gelé le salaire des membres de la direction et a appliqué un gel des embauches de personnel non enseignant, « sauf pour les postes essentiels à [sa] mission ». Des mesures qui inquiètent l’Association des professeurs de l’Université Concordia.
« Jusqu’à présent, la direction de l’université nous a informés d’un gel salarial pour le personnel de la haute direction. Il a également été demandé aux directeurs de département d’abandonner les cours [auxquels il y a sous-inscription] afin de limiter les coûts, ce qui nous préoccupe beaucoup », écrit le syndicat dans un courriel au Devoir. Il dit notamment craindre que l’abandon par l’université de certains cours moins prisés mine « la cohérence des programmes et [ait] un impact négatif sur la charge de travail des professeurs ».
À l’Université McGill, qui n’a pas répondu aux questions du Devoir, un gel des embauches qui vise le personnel tant enseignant qu’administratif a été annoncé le 1er décembre dernier. Mario Roy, président de l’Association des étudiants diplômés employés de McGill, qui représente les auxiliaires d’enseignement de l’établissement, s’inquiète que ces restrictions budgétaires viennent à terme alourdir la charge de travail de ses membres, dont le syndicat se bat actuellement pour alléger les conditions de travail et améliorer les salaires. « Avec les coupes budgétaires annoncées, on craint que les problèmes que l’on vit déjà s’accentuent. »
D’importants besoins
L’Université du Québec à Montréal (UQAM) évalue pour sa part son manque à gagner annuel à 50 millions de dollars. Une somme qui atteint 104 millions du côté de l’Université Laval, laquelle s’attend tout de même à être en mesure d’équilibrer son budget cette année, après avoir poursuivi l’an dernier des « travaux d’actualisation de son cadre budgétaire et de gestion intégrée des risques ». Ainsi, « nous considérons que nous manquons indéniablement de moyens financiers pour développer notre université », confirme le porte-parole Simon La Terreur.
L’Université de Sherbrooke, quant à elle, note que l’équilibre de son budget d’une année à l’autre « se fait nécessairement au prix de sous-investissements dans les infrastructures technologiques et dans les mesures de soutien à l’enseignement et à la recherche » en raison du « sous-financement » par l’État. « À long terme, ces sous-investissements ont un impact important sur nos établissements. »
La présidente de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université, Madeleine Pastinelli, constate que les professeurs doivent souvent s’occuper de tâches administratives qui ne leur incombaient pas auparavant quand les universités limitent l’embauche de différents types d’employés. « La surcharge de travail des professeurs est devenue intenable », dénonce-t-elle.
Les universités offrent en parallèle de plus en plus de cours en ligne, qui permettent l’inscription de plus d’étudiants malgré un nombre limité de professeurs. L’Université Laval a ainsi vu le nombre de ses cours offerts entièrement à distance passer de 393 à 893 entre l’automne 2019 et l’automne 2023, et la part d’étudiants inscrits uniquement à ce type de cours, de 18 % à 29 %. À l’Université de Montréal, ce sont 6 % des cours qui sont uniquement offerts en ligne, contre 2 % il y a quatre ans, tandis qu’à l’Université de Sherbrooke, le pourcentage d’étudiants inscrits à des cours à distance a doublé depuis 2019 et ainsi atteint 8,2 % l’automne dernier.
L’UQAM indique que « le quart de [ses] groupes-cours revêtent une composante à distance, hybride ou comodale ». Une situation qui préoccupe Olivier Aubry, président du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM, qui représente les chargés de cours de l’établissement. « Si on a moins de revenus, bien souvent, on va faire des coupes dans l’enveloppe de charge ou dans les services. C’est là où ça devient plus compliqué pour nous, si on coupe certains cours ou qu’on a tendance à augmenter le nombre d’étudiants par cours », notamment en offrant plus de formations à distance, relève M. Aubry.
Le virage numérique, pas une panacée
L’Université TELUQ, qui donne tous ses cours en ligne, affirme pour sa part que ce virage numérique n’est pas une solution miracle pour améliorer l’état financier des établissements postsecondaires. L’université prévoit en fait un déficit de 3 millions de dollars cette année, confie sa directrice générale, Lucie Laflamme. Et ce, malgré un bond de ses étudiants observé dans le contexte de la pandémie. Une situation qui s’explique par le fait que 92 % de ses 20 000 étudiants sont à temps partiel. L’université ne bénéficie ainsi que d’un financement équivalant à 4000 étudiants à temps plein de la part du gouvernement Legault, ce qui limite sa capacité à recruter des professeurs et des employés.
Or, pour bien faire l’enseignement en ligne, « ça prend les ressources, ça prend les infrastructures et l’accompagnement de nos profs. Et en effet, si on fait juste grossir les classes, on peut se questionner sur la qualité de l’encadrement », poursuit Mme Laflamme.
Joint par Le Devoir, le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, assure être « conscient des défis auxquels les universités peuvent faire face actuellement ». La nouvelle politique de financement des universités attendue cette année devrait d’ailleurs être « adaptée aux besoins et à la réalité » de celles-ci, assure-t-on. Le cabinet de Mme Déry note d’ailleurs que la croissance des budgets alloués par Québec aux universités avoisine 39 % depuis 2018. « Jamais un gouvernement n’aura autant investi en enseignement supérieur », affirme-t-on.
On verra si la politique “déshabiller Pierre pour habiller Paul, sans investir pour rattraper le déficit accumulé” va aider les universités…
Le débat linguistique n’était qu’une distraction (surprise!).
Très vite, la réalité du sous-financement universitaire “across the board” – une faute portée exclusivement par le gouvernement, et non par certains établissements particuliers – nous rattrape.
À CityNews
Montreal’s Concordia University sees ‘concerning’ drop in applications
“It’s very concerning for us,” says Graham Carr, president of Montreal’s Concordia University, after a 30 per cent drop in applications from out-of-province students due to Quebec’s tuition hikes and French requirement. Alyssia Rubertucci reports.
Dans une autre nouvelle… ingérance politique dans les affaires de l’INRS?
Des étudiants de l’INRS veulent un «front commun» pour dénoncer le blocage d’une prof au CA
Photo: Hélène Simard, Creative Commons
L’INRS estime aussi que la décision de la ministre Déry est inhabituelle et contrevient à l’autonomie universitaire. Le Syndicat des professeurs de l’INRS et la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université ont aussi dénoncé le geste du cabinet Déry.
Marie-Michèle Sioui
à Québec
Correspondante parlementaire
16 h 14
Éducation
Une association étudiante de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) a sollicité ses membres lundi afin qu’ils expriment leur soutien à la professeure titulaire Denise Helly, dont la nomination a été bloquée au conseil d’administration (CA) de l’établissement par le gouvernement du Québec.
Dans un courriel, l’Association étudiante de l’INRS Centre – Urbanisation Culture Société (AÉUCS-INRS), fait état de ses inquiétudes face à « l’ingérence politique dans les affaires universitaires ». L’AÉUCS-INRS représente environ une centaine d’étudiants. Par sa démarche, elle tente de rallier des associations étudiantes et les universités du Québec pour former un front commun contre la décision du gouvernement.
La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a semé l’émoi chez les professeurs, dans les partis d’opposition et dans les plus hautes sphères de l’Université du Québec (UQ) en bloquant la nomination au CA de l’INRS de la professeure Helly. Celle-ci s’intéresse, dans ses travaux, au multiculturalisme, à l’islamophobie et au racisme systémique, notamment.
Le grand patron de l’UQ, Alexandre Cloutier, a dit voir dans le geste de Québec une atteinte à l’autonomie des universités et, possiblement, à la liberté universitaire. Ces deux principes sont enchâssés dans la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire, adoptée par le gouvernement de François Legault en juin 2022.
L’INRS estime aussi que la décision de la ministre Déry est inhabituelle et contrevient à l’autonomie universitaire. Le Syndicat des professeurs de l’INRS et la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université ont aussi dénoncé le geste du cabinet Déry.
Une prof « courageuse »
Dans le courriel transmis à ses membres, l’AÉUCS-INRS propose de faire « front commun contre la tentative du gouvernement d’interférer avec l’indépendance scientifique, compromettant ainsi notre avenir dans le monde académique ». Selon nos informations, elle a communiqué avec une vingtaine d’associations à travers le Québec.
L’association fustige la décision de la ministre Déry, qui pourrait avoir « des conséquences sérieuses » selon elle, notamment chez les étudiants en sciences sociales. « Par crainte, et avec raison, de ne plus recevoir de financement de la part du gouvernement du Québec, les futurs chercheurs de ce pays pourraient être découragés et dissuadés d’entreprendre des recherches qui ne sont pas alignées avec les positions du gouvernement en place », écrit-elle.
L’AÉUCS-INRS avance que les étudiants sont « scandalisés » par cette affaire, et que ceux qui fréquentent l’INRS souhaitent « apporter [leur] soutien le plus sincère et total à la professeure Denise Helly, qui vit une situation totalement injuste et discriminatoire ». L’association affirme que la professeure titulaire est « courageuse, car, comme cette affaire le démontre, être chercheur en sciences sociales concernant des sujets qui ne conviennent pas à l’agenda politique de la ministre Pascale Déry, c’est s’exposer à la censure et à la discrimination ».
Jusqu’ici, le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur a dit ne pas vouloir commenter cette affaire.
Google Canada injecte 1,3 M$ à l’institut de cybersécurité IMC2 à Montréal
Google a établi à Montréal sa deuxième plus importante équipe de cybersécurité.
PHOTO : ICI EXPLORA
La Presse canadienne
Publié hier à 13 h 09 HNE
L’Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience (IMC2), créé par Polytechnique Montréal en partenariat avec l’Université de Montréal et HEC Montréal, recevra un financement de 1,3 million de dollars de la part de Google Canada.
La contribution de Google Canada à l’institut de recherche, créé il y a huit mois, a pour objectif d’appuyer la recherche sur les cyberrisques qui sont en croissance à l’échelle mondiale.
L’annonce a eu lieu jeudi matin lors d’une conférence de presse dans les bureaux de Google à Montréal.
En soutenant l’IM2, Google reconnaît l’urgence de la sécurité numérique.
— Isabelle Péan, présidente-directrice générale de la Fondation de Polytechnique
François Bertrand, directeur de la recherche et de l’innovation à Polytechnique Montréal, a déclaré : « [Grâce à Google], nous pouvons offrir toujours plus de moyens à nos profs, chercheuses et chercheurs, leur permettant ainsi d’explorer de nouvelles avenues propices à l’émergence d’innovations. »
Google a également annoncé qu’elle permettrait aux francophones de suivre le certificat en cybersécurité de Google dans leur langue maternelle. Ce cours en ligne doit permettre de préparer les gens à un emploi de niveau débutant en cybersécurité en moins de six mois.
Selon l’Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience, on prévoit que les coûts mondiaux de la cybercriminalité atteindront 10 500 milliards de dollars américains (14 180,8 milliards de dollars canadiens) par an d’ici 2025. Les rançongiciels à eux seuls coûteront à leurs victimes environ 265 milliards de dollars américains (367,9 milliards de dollars canadiens) par an d’ici 2031.
Cette annonce survient dans une période de licenciements pour Google, qui a déjà annoncé la mise à pied de plusieurs centaines de personnes, notamment en publicité, mais aussi dans ses équipes responsables du matériel informatique (Pixel, Nest, Fitbit, etc.), de l’assistance vocale et de l’ingénierie.
Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que d’autres annonces du genre auraient lieu cette année.
L’UQAM offrira une voie rapide pour les enseignants dès septembre
Alors que l’idée d’une formation courte pour qualifier de nouveaux professeurs faisait presque l’unanimité contre elle il y a un an, l’UQAM fait volte-face et offrira dès septembre une formation de 30 crédits menant au brevet d’enseignant au primaire. La formule, unique au Québec, est testée depuis cet été.
Nassima Menour est l’une des huit personnes, à la fois enseignantes et étudiantes, qui participent au projet-pilote entre l’UQAM et le CSSPI pour qualifier ceux qui enseignent déjà dans les classes sans qualification légale.
PHOTO : RADIO-CANADA / FANNIE BUSSIÈRES MCNICOLL
Julie Marceau
Fannie Bussières McNicoll
Publié à 4 h 00 HNE
« Je suis contre l’idée de donner un brevet à rabais », déclarait sans détour le doyen de la Faculté d’éducation de l’UQAM Jean Bélanger au Journal de Québec en février 2023.
Jean Bélanger réagissait alors aux sept priorités du ministre Bernard Drainville (dont celle de créer une voie rapide) à titre de président de l’association représentant les doyens des facultés d’éducation (ADÉREQ).
Le doyen ne s’en cache pas : il était très perplexe et estimait que ça allait trop vite. La sortie du ministre Drainville a eu un effet d’électrochoc, reconnaît-il.
Malgré ses réticences, celui qui cumule plus de 20 ans d’expérience au Département d’éducation de l’UQAM souhaitait lutter contre la pénurie d’enseignants, mais pas n’importe comment, précise-t-il.
Jean Bélanger a interpellé tous les professeurs de la faculté en disant : il faut faire quelque chose. J’ai levé la main, et les choses se sont placées très rapidement, raconte Elaine Turgeon, directrice de l’Unité des programmes de 1er cycle en éducation préscolaire et en enseignement primaire (ÉPEP).
Élaine Turgeon a aidé à la conception du nouveau programme de l’UQAM, qui vient d’être approuvé à l’interne pour un démarrage officiel à l’automne 2024.
PHOTO : RADIO-CANADA / PATRICK ANDRÉ PERRON
On avait ce souci de contribuer, d’aider à notre façon, ajoute-t-elle.
[Si on ne fait pas ça], on laisse les gens qui ne sont pas formés dans les classes et on prend le risque que [leurs élèves] ne fassent pas les apprentissages nécessaires, qu’ils accumulent un retard, et après, on va avoir un problème de société.
— Élaine Turgeon, enseignante en didactique, directrice de l’Unité des programmes de 1er cycle en éducation préscolaire et en enseignement primaire (ÉPEP), UQAM
Élaine, c’est vraiment l’idéatrice du projet, insiste Jean Bélanger.
C’est ainsi que le diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) de l’UQAM de 30 crédits, à temps partiel sur deux ans, est né. Ce sera le premier programme permettant rapidement à des professeurs de se qualifier par une formation offerte en présentiel, et non entièrement à distance, comme d’autres formules existantes.
La TÉLUQ propose un programme de 30 crédits pour qualifier les enseignants non légalement qualifiés qui enseignent déjà au primaire, mais la formation est entièrement donnée à distance. Même chose pour la voie rapide de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) qui vise l’enseignement au secondaire.
Les formations de l’UQAM, la TÉLUQ et l’UQAT ont toutefois un point commun : elles concernent les enseignants non légalement qualifiés, c’est-à-dire des professeurs déjà embauchés dans le réseau scolaire.
Selon les plus récents chiffres compilés par le ministère de l’Éducation, plus de 7000 personnes non légalement qualifiées ont un contrat à temps plein ou à temps partiel actuellement. En incluant les suppléants, ce chiffre bondit à 30 000, selon la vérificatrice générale du Québec.
Avec ces personnes-là, on peut aller beaucoup plus rapidement qu’avec des étudiants qui sortent du cégep, qui ont 19 ans et qui n’ont pas nécessairement d’expérience des classes du primaire et des élèves du primaire, explique Elaine Turgeon.
C’est une formation dans l’action, poursuit-elle.
Pour être acceptés à l’UQAM, les futurs brevetés devront avoir déjà en main un baccalauréat et avoir été sélectionnés par le centre de services scolaire qui les emploie avec une charge de travail d’au moins 60 %.
Présentement, le seul centre de services scolaire partenaire de l’UQAM dans ce projet est le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CCSSPI).
Des résultats prometteurs, selon l’UQAM et le CSSPI
Huit étudiants participent depuis la fin de l’été 2023 à un projet pilote qui a permis de peaufiner le programme qui sera offert à l’automne. Ils sont tous enseignants non légalement qualifiés dans une école du CSSPI, dans l’est de Montréal.
La formule retenue par l’UQAM offre un avantage unique, selon le CSSPI : les étudiants sont encadrés par une équipe de l’université. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes une fois les cours octroyés ou des capsules vidéo écoutées. Une vingtaine de professeurs de l’UQAM supervisent les futurs brevetés jusque dans leurs classes. Autrement dit : tout ne repose pas sur les épaules des équipes-écoles du CSSPI déjà surchargées.
On appelle ça une pratique supervisée, explique Elaine Turgeon. Le programme est composé de cours multidisciplinaires structurés autour des temps forts d’une année scolaire complète, comme la préparation aux examens et la remise des bulletins, au lieu d’être dans une logique traditionnelle de cours unithématique de 45 heures, ajoute-t-elle.
C’est pas juste d’obtenir le papier, c’est de faire en sorte que cette qualification légale soit liée à un développement de compétences […] avec toute la rigueur qu’exige une formation universitaire, explique Martin Duquette, directeur général adjoint du CSSPI.
Est-ce que notre programme à l’UQAM est unique? Je pense que oui. On a trouvé une formule qui nous convient et qui, jusqu’à maintenant, semble bien fonctionner.
— Jean Bélanger, doyen de la Faculté des sciences de l’éducation, UQAM
Se gardant bien de décocher une flèche à l’endroit des universités encore réfractaires aux formations courtes, Martin Duquette se permet néanmoins d’en appeler à une plus grande flexibilité des universités.
Martin Duquette, directeur général adjoint du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CCSSPI).
PHOTO : RADIO-CANADA / PATRICK ANDRÉ PERRON
C’est pas de niveler par le bas, c’est de maintenir des standards, mais dans une souplesse qui reflète plus la réalité d’aujourd’hui, dit-il.
Un programme « sur mesure pour mes besoins »
Et la pertinence de cette souplesse, Nassima Menour, l’une des huit étudiantes du projet pilote l’UQAM, en sait quelque chose.
Cette Algérienne d’origine, qui enseigne déjà dans trois classes du CSSPI et qui aspire à se qualifier comme enseignante, est également mère de trois enfants.
Ingénieure hydrogéologue de formation comme son mari, elle est arrivée au Québec avec sa famille en 2009. Lui s’est réorienté vers les soins infirmiers. Elle a plongé dans le milieu de l’éducation, sachant très bien que les besoins en main-d’œuvre y étaient criants.
Nassima a rapidement eu la piqûre pour le contact avec les enfants et a développé le désir d’être enseignante au primaire. Durant son entrevue d’embauche pour être prof suppléante, le CSSPI lui a recommandé d’emblée d’aller chercher son brevet en enseignement.
Je me suis dit : c’est impossible! Je ne peux pas m’engager dans un baccalauréat, c’est trop avec la charge familiale et le travail. […] Ça va s’arrêter à la suppléance, raconte-t-elle.
Mais lorsqu’elle a eu vent du projet pilote de 30 crédits instauré par l’UQAM, elle a sauté sur l’offre.
Là, je me suis dit : c’est une occasion comme jamais, il faut pas rater ça!
Elle apprécie le suivi personnalisé offert par le corps enseignant de l’UQAM. « J’ai une réponse rapide à mes questions et je peux rapidement passer à l’exécution, en classe. »
Nassima Menour est enchantée par les premiers cours suivis jusqu’à présent dans ce nouveau programme de l’UQAM, et par l’accompagnement offert.
PHOTO : RADIO-CANADA / PATRICK ANDRÉ PERRON
C’est un programme qui est vraiment fait sur mesure pour moi, pour mes besoins. Cette formation va m’outiller et me permettre d’exercer mon métier à 100 % et de donner un service de qualité.
— Nassima Menour, enseignante en cours de qualification à travers le nouveau programme court de l’UQAM en enseignement
Qualifier rapidement tout en respectant la qualité de la formation
Le défi, selon Martin Duquette, est de former de façon réaliste, et en fonction de leurs horaires déjà chargés, ces personnes extraordinaires qui lèvent la main.
Car ces personnes seront de plus en plus précieuses dans les prochaines années.
On n’a rien vu encore par rapport à la pénurie.
— Elaine Turgeon, directrice de l’Unité de programmes de 1er cycle en éducation préscolaire et en enseignement primaire (ÉPEP)
Élaine Turgeon enseigne un samedi après-midi aux participants du projet pilote, dont Nassima Menour.
PHOTO : RADIO-CANADA / PATRICK ANDRÉ PERRON
Selon les plus récentes prévisions du ministère de l’Éducation, en jumelant le nombre actuel de diplômés en enseignement et l’augmentation de départs à la retraite, plus de 14 000 enseignants, 6000 d’entre eux sont affectés à un poste à temps plein ou partiel, manqueront à l’appel d’ici quatre ans, soit 3600 en moyenne chaque année.
Le doyen de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, Jean Bélanger, rêve de qualifier à terme près d’une centaine de professeurs par année via ce nouveau programme. Un nombre modeste, convient-il, mais réaliste pour s’assurer de la qualité de la formation, sensiblement plus courte.
L’UQAM est également en train de remanier son baccalauréat menant au brevet d’enseignement au préscolaire et au primaire.
Il pourrait y avoir une voie plus rapide, mais sans sacrifier l’atteinte de l’objectif qui est de s’assurer que les gens dits qualifiés ont vraiment les qualifications qu’ils sont supposés avoir. Je lâcherai pas ce morceau-là, poursuit-il.
On a accepté de prendre le risque d’aller aussi vite parce qu’on nous poussait dans le dos, certes, mais le ménage va peut-être être à faire, éventuellement, dans tous les programmes [créés au Québec depuis la sortie du ministre Drainville], prévient-il.
Un amendement ajouté au projet de loi 23 – soit la grande réforme en éducation du ministre Bernard Drainville – permet officiellement aux formations courtes de l’UQAT, de la TÉLUQ et de l’UQAM de mener au brevet d’enseignement.
Les diplômés se verront tout d’abord délivrer un permis probatoire d’enseigner. Ceux-ci devront par la suite effectuer un stage probatoire de 600 à 900 heures sous la responsabilité de l’employeur avant de pouvoir obtenir leur brevet d’enseignement, selon des informations partagées par le ministère de l’Éducation.
L’UQAM a amorcé la semaine dernière une consultation auprès de la communauté étudiante sur la transformation de sa Bibliothèque centrale, qui pourrait comprendre des travaux à l’intérieur et l’extérieur du pavillon A
Métamorphose à la Bibliothèque centrale
Une consultation est lancée afin de cerner les besoins des personnes qui fréquentent les bibliothèques.
La consultation comprendra également des rencontres ciblées avec des groupes étudiants, des membres du personnel enseignant ainsi que des membres du personnel cadre et de soutien.
Pierre-Etienne Caza
23 janvier 2024
Devant les besoins grandissants de la communauté et les changements technologiques qui s’accélèrent, l’UQAM entreprend un ambitieux projet de transformation de sa Bibliothèque centrale, qui inclut la Bibliothèque des arts, la Bibliothèque des sciences de l’éducation et la Bibliothèque des sciences juridiques et politiques. Le projet Métamorphose vise à offrir de nouveaux environnements numériques, des espaces de travail collaboratifs transformés et connectés, des aires de socialisation et d’expérimentation ainsi que des laboratoires interdisciplinaires.
«Nous avons un rêve: celui de créer une bibliothèque contemporaine, caractérisée par l’innovation, la collaboration et l’ouverture. Ce lieu deviendra un véritable milieu de vie, d’études et de socialisation pour toutes les personnes qui fréquentent l’UQAM», affirme le recteur Stéphane Pallage.
«La métamorphose de la Bibliothèque centrale viendra renforcer l’esprit créatif et innovateur de l’UQAM, en modernisant la vision d’une bibliothèque universitaire, en plus de participer à la revitalisation des pavillons Hubert-Aquin, Thérèse-Casgrain et Paul-Gérin-Lajoie, et à la relance du Quartier latin», souligne pour sa part le vice-recteur aux Systèmes d’information Louis-Sébastien Guimond.
Une consultation élargie
«Les bibliothèques de l’UQAM ont besoin de se moderniser et le nom du projet n’est pas anodin, observe Frédéric Giuliano, directeur général du Service des bibliothèques. Nous assisterons bel et bien à une métamorphose de nos espaces, tant et si bien qu’à la fin du processus, ce ne sera plus la même bibliothèque, ni physiquement ni dans l’offre de services.»
On souhaite, notamment, diversifier les types d’espaces, d’ambiances et de mobiliers afin d’offrir à la fois des lieux de travail, de socialisation, de diffusion et d’expérimentation. On compte aussi miser sur l’ajout de baies vitrées pour faire entrer la lumière naturelle. Une analyse structurale sera également réalisée afin d’évaluer les possibilités que la bibliothèque ait pignon sur rue.
La nature détaillée de ces transformations, qui reste à définir, fait l’objet d’une consultation élargie menée auprès des membres de la communauté universitaire. «Ce sont les usagers et les usagères qui sont les mieux placés pour nous alimenter en fonction de leurs besoins. Cela nous aidera à mieux définir le projet», précise Frédéric Giuliano en invitant les personnes intéressées à participer à un sondage en lien avec les espaces de travail et les services offerts aux bibliothèques. La consultation comprendra également des rencontres ciblées avec des groupes étudiants, des membres du personnel enseignant ainsi que des membres du personnel cadre et de soutien.
À l’instar de l’équité, la diversité et l’inclusion, l’écoresponsabilité sera au centre des préoccupations et des valeurs du projet. Un groupe de travail se penchera sur cette question et ses recommandations seront prises en considération.
Une transformation numérique
Vouloir donner plus d’espace aux usagers et usagères de la bibliothèque centrale implique nécessairement de repenser l’organisation des collections. «Nos collections totalisent plus de 1,2 million de documents physiques, soit l’équivalent, en superficie, de trois terrains de football, révèle Frédéric Giuliano. Avec le projet Métamorphose, nous comptons diminuer cet espace de 50 %. Attention, cela ne signifie pas que nous élaguerons la moitié de nos documents. Nous en retirerons certains selon des critères précis, mais nous miserons également sur une densification de certains espaces d’entreposage et sur une transformation numérique.»
Les bibliothèques du XXIe siècle sont définitivement tournées vers le numérique. À preuve, 95 % du budget d’acquisition des bibliothèques de l’UQAM est dévolu aux ressources électroniques. «Cette transformation s’observe dans l’ensemble des bibliothèques universitaires, constate Frédéric Giuliano. Le comportement informationnel a évolué et il faut s’y adapter. Les usagers et usagères empruntent de moins en moins de documents sur support papier. En parallèle, nous bonifions sans cesse nos abonnements numériques afin de demeurer à la fine pointe de ce qui se publie, ce qui est crucial pour soutenir la recherche et la création.»
Mettre en valeur l’unicité de certaines collections
Le passage au numérique ne doit toutefois pas faire oublier que l’UQAM possède, en plus des documents conservés précieusement au Centre des livres rares et collections spéciales, certaines collections uniques au Canada, telles que la collection de la bibliothèque de l’École des beaux-arts de Montréal, la collection Pouchet et la collection Autochtonie. «Une bibliothèque est un lieu de découverte, mais on ne peut pas découvrir ce que l’on ne voit pas, note le directeur général. Il faudra donc s’assurer de mettre en valeur ces collections en facilitant leur accessibilité. Par exemple, nous avons une collection de catalogues d’art d’une grande richesse. Or, il faut réfléchir aux espaces pour consulter ce type de documents, souvent de grands formats volumineux.»
Toutes les idées sont les bienvenues
Frédéric Giuliano a hâte de prendre connaissance des résultats de la consultation. Les idées ne manqueront pas, il en est convaincu. Serait-il envisageable, par exemple, qu’un café s’installe au sein de la bibliothèque? «Tout à fait! Les bibliothèques où l’on ne peut ni manger ni boire un café sont d’une autre époque. Je le répète: toutes les idées soumises mériteront réflexion.»
Il est dès à présent possible de faire un don à la Fondation de l’UQAM pour le projet Métamorphose en cliquant sur le bouton «Faire un don» qui apparaît sur le site.
Des bornes de prêt en libre-service
Un nouveau service de prêt en libre-service sera déployé progressivement au cours de l’hiver 2024 à la Bibliothèque centrale, à la Bibliothèque de musique et à la Bibliothèque des sciences afin de favoriser l’autonomie des usagers et usagères qui empruntent des ouvrages imprimés.
Une fois les bornes installées, une période de rodage permettra de tester l’équipement et de mesurer l’adhésion ainsi que la satisfaction de la communauté à l’égard du nouveau service.
Excellente nouvelle que cette métamorphose de la bibliothèque centrale annoncée par l’UQAM. Non seulement cela participera, je l’espère, à la revitalisation de certains pavillons mais ‘‘l’ouverture’’ souhaité par le recteur permettra à l’Université de finalement jouer un plus grand rôle dans le Quartier latin et du coup de renforcer le caractère francophone du secteur tel que prescrit par la Mairesse dernièrement.
Il est primordial que l’UQAM devienne le leader incontesté du Quartier latin et pour ce faire c’est en pleins le genre de geste qu’elle doit poser. Et cela me fait bien rire car pas plus tard que ce matin j’ai justement envoyé un courriel au recteur pour lui faire part de quelques suggestions qui vont exactement dans ce sens. Pour être bien honnête, je trouve que l’UQAM est trop renfermée sur elle-même et qu’on ne la sent pas beaucoup malgré qu’elle soit partout. Il est plus que temps qu’elle s’ouvre à la rue et au quartier pour ne pas dire aux nombreux passants. Je veux sentir sa présence partout et être invité à rentrer dans ses espaces que ce soit dans la bibliothèque, la galerie d’art, le jardin etc.
Donc pour l’instant je dis un gros bravo à l’UQAM !
Quebec government ignored advice to ditch out-of-province tuition hikes
Government advisory committee says hikes will compromise education access
Antoni Nerestant · CBC News · Posted: Feb 02, 2024 5:31 PM EST | Last Updated: 1 hour ago
Concordia University is among the three English-language universities in the province that will be affected by the Quebec government’s plan to hike tuition. (Ryan Remiorz/The Canadian Press)
Quebec is sticking with its plan to impose a significant increase in tuition for out-of-province students, ignoring advice from a government advisory committee in the process.
The Comité Consultatif sur l’Accessibilité Financière aux Études — a committee that studies issues regarding education access — raised several concerns about the upcoming tuition hike in a Jan. 19 letter to Higher Education Minister Pascale Déry, which was obtained by CBC News.
Starting this fall, Canadian students living outside of Quebec will see their tuition go from about $8,992 to $12,000.
The province had initially pushed to raise tuition to $17,000 but essentially lowered the price tag in exchange for a commitment from English-language universities to ensure 80 per cent of their non-Quebec Canadian students and international students demonstrate a Level 5 oral proficiency in French by the end of their undergraduate studies.
International students will see their minimum tuition fees set at roughly $20,000.
According to the Coalition Avenir Québec (CAQ) government, the increase in tuition and the obligation to learn French are part of an effort to bolster French in the province, especially in the Montreal area. A good chunk of the extra money is to be used by the government to boost funding for French-language universities.
In its letter, however, the advisory committee questions the CAQ government’s rationale for the severity of the increase and says it would like to have more data to understand it. It says the move isn’t justified and “risks compromising access to quality education and to deprive society of potential talents.”
“The committee invites [the government] to re-evaluate these costs to preserve the equality of opportunity and to prioritize an inclusive and diverse education environment,” the letter reads.
McGill University, expected to be one of the institutions hardest hit by the policy, issued a statement, highlighting that it has asked the ministry “repeatedly” for data justifying the move.
“We would welcome a response,” the statement reads.
Concordia University also issued a statement, saying the committee’s opinion “adds to the chorus of voices that have already noted their negative impact, including the mayor of Montreal and the Chamber of Commerce.”
The university urged the Quebec government to take the committee’s views seriously.
By the looks of things, it will not.
And that’s at least partly due to the fact the committee submitted its opinion four days after the deadline the higher education minister had set. A spokesperson for the minister told CBC News that it’s moved on to the next step in implementing the new tuition model and pointed out the fact that the committee did not respect the deadline.
The spokesperson also said the committee’s opinion didn’t seem to take into account the government’s reasons for hiking the fees: addressing the imbalance in funding between French-language and English-language universities and and minimizing the extent to which Quebecers fund the education of non-Quebecers.
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/advisory-committee-mcgill-concordia-déry-1.7103593
À quoi bon des comités gouvernementaux d’experts quand les politiciens détiennent les vérités absolues! /s
À l’UQAC, un étudiant sur trois est étranger
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
Campus de l’Université du Québec à Chicoutimi
Sur le campus de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), à près de cinq heures de route de Montréal, un étudiant sur trois vient d’un autre continent.
Publié à 5h00
![]()

Edouard Plante-Fréchette La Presse
Dans certaines classes, il y a plus d’étrangers que d’étudiants locaux.
Marie-Josée Roy, par exemple, donne un cours de comptabilité, suivi par 125 étudiants, dont 120 sont d’ailleurs.
Le dioula et le wolof se mélangent au français et à d’autres langues dans les couloirs et les cafés de l’université, qui domine la rivière Saguenay.
De nouveaux commerces africains ont pignon sur rue : le Sèlô Resto a ouvert ses portes en octobre sur le boulevard Talbot, près du Bar Le Baobab, et le Marché africain du Saguenay s’est installé en novembre, rue Racine Est, à quelques minutes de marche de la pâtisserie QueBeclava, haut lieu, comme on le devine, du baklava.
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
Au premier plan, Mamadi Oulare, de la Guinée, étudie en génie civil, à l’Université du Québec à Chicoutimi.
Des étudiants étrangers fréquentent l’UQAC depuis plus de 20 ans. Ce n’est pas nouveau. En 2012, ils étaient 500. En 2019, 1500. Mais depuis la crise liée à la COVID-19, cette clientèle connaît un boum. En proportion, l’UQAC compte aujourd’hui autant d’étudiants venant de l’étranger que McGill.
Hausse des Africains
Les nouveaux venus sont surtout africains. Cette année, sur 6500 étudiants, 2125 viennent d’ailleurs : 50 % de l’Afrique francophone, 41 % de la France et 9 % de 50 autres pays.
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
Youssouf Brahami, d’Algérie, Ghada Gmati, de Tunisie, et Békibenan Sékongo, de Côte d’Ivoire, dans le laboratoire de modélisation et diagnostic des équipements des lignes électriques de l’UQAC
Saguenay n’est pas la seule ville à miser sur les étudiants étrangers pour assurer sa croissance. Mais elle semble mener cette course. La proportion d’étudiants étrangers de l’UQAC est plus du double de celle de l’UQAM (14 %) et des autres universités régionales du réseau de l’Université du Québec.
« Les Français viennent souvent en double diplomation », explique Marie-Karlynn Laflamme, directrice des communications. « Dans leur cursus scolaire, ils ont une obligation d’aller passer une année à l’international. Souvent, ils nous choisissent. Mais ils ne sont que de passage. Les Africains, ce sont des étudiants réguliers. Ils veulent s’installer ici. C’est ça qui a complètement changé. »
Sanae Benaissa, 27 ans, a entrepris son doctorat à l’UQAC en 2021. « Je dois finir à l’automne 2024 », précise la Marocaine. Restera-t-elle à Chicoutimi ? « Ça dépend des opportunités. Je préférerais rester. Mais c’est sûr que je ne retourne pas vivre au Maroc. »
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
Sanae Benaissa dans le laboratoire international des matériaux antigivre, où elle fait son doctorat.
Ghada Gmati, 28 ans, de Tunisie, étudie aussi au doctorat. Elle a fait un stage de trois mois à l’UQAC, en 2019, avant de revenir en 2021 pour entreprendre des études de 3e cycle. « J’aime la région, la verdure, le calme. Ici, c’est vraiment moi, déclare-t-elle. Je me sens à l’aise ici. Je compte demander la résidence permanente. L’important, pour moi, c’est de rester au Québec. »
17 000 demandes
Comment cette université, loin des grands centres, dans une région réputée pour ses hivers longs et froids, est-elle devenue un pôle d’attraction pour des jeunes de partout dans le monde ?
Plusieurs facteurs expliquent son succès. Le premier : l’UQAC multiplie les efforts. Vingt-deux missions ont lieu chaque année, principalement en France, pour démarcher des étudiants.
« Ceux qui arrivent ici, la première chose que je leur dis, c’est bravo ! », lance Guylaine Boivin, directrice du bureau de l’international à l’UQAC. « Parce que c’est un parcours du combattant. »
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
Guylaine Boivin, directrice du bureau de l’international à l’UQAC
L’an dernier, l’université a reçu un nombre record de 17 000 demandes d’admission d’étudiants d’ailleurs. Elle en a accepté 10 000 ! Il en est finalement venu 2125, dont 400 nouveaux en janvier. Les autres ? Ils ont opté pour une autre université québécoise, ou ont échoué à obtenir le visa d’études délivré par le gouvernement fédéral.
« Les étudiants étrangers, c’est une richesse et une nécessité, explique Guylaine Boivin. Ça enrichit l’expérience universitaire, ça permet le maintien de certains programmes et le développement de nouveaux programmes, notamment aux cycles supérieurs. »
Vers l’immigration
Il faut savoir que la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean est vieillissante. L’université ne peut donc pas compter seulement sur la jeunesse locale pour assurer son développement.
Les étudiants étrangers procurent aussi des revenus essentiels au fonctionnement de l’université. Les droits de scolarité varient selon le programme, mais pour les étudiants étrangers, ils s’élèvent généralement à 23 000 $ par année, soit environ huit fois plus que ce que paient les étudiants québécois. Les étudiants français et belges doivent verser autour de 10 000 $ par an, en vertu d’ententes avec le gouvernement du Québec.
Pour les étudiants, en plus d’une expérience de vie à l’étranger, étudier à Saguenay est souvent un moyen d’accéder à la résidence permanente. Québec offre une voie rapide vers l’immigration aux étudiants étrangers francophones diplômés ici.
C’est ce que compte faire l’Iranienne Samaneh Keshavarzi, 35 ans, étudiante au doctorat au laboratoire de revêtements glaciophobes et ingénierie des surfaces. « Je suis des cours de francisation le soir depuis trois ans », précise-t-elle.
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
Les Iraniennes Samaneh Keshavarzi et Saba Goharshenas Moghadam font leur doctorat au laboratoire LaRGIS (Revêtements glaciophobes et ingénierie des surfaces) de l’UQAC.
Saba Goharshenas Moghadam, 30 ans, qui fait son doctorat dans le même laboratoire, veut aussi s’établir ici.
Tout comme Maria Loaiza, 24 ans. « Je vais demander la résidence permanente après mes études », assure la Colombienne, inscrite à la maîtrise. « J’irai peut-être à Montréal. »
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
Maria Loaiza, de la Colombie, dans le laboratoire international des matériaux antigivre (LIMA) de l’UQAC, où elle fait sa maîtrise.
Békibenan Sékongo, lui, veut rester à Saguenay, où il a fait un doctorat sur les décharges électriques, avant d’entreprendre un postdoctorat en 2023. « J’aime l’hiver. Ici, on n’a vraiment pas chaud comme chez moi ! », rigole l’Ivoirien de 38 ans.
Youssouf Brahami, son collègue de 34 ans, est du même avis. « Je suis ici depuis mai 2023 avec ma femme et mon fils qui aura bientôt 3 ans », précise le postdoctorant algérien, dans le laboratoire de modélisation et diagnostic des équipements des lignes électriques. « On aimerait rester. Il y a des possibilités d’emploi dans la région. »
Des efforts « gigantesques »
Le nombre d’étudiants étrangers est en explosion au Canada. Pas seulement à Saguenay. En 2023, le fédéral a délivré 900 000 visas d’études. Trois fois plus qu’il y a 10 ans.
Mais cette hausse va se transformer en baisse dès cette année. Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a annoncé le 22 janvier l’imposition d’un quota de deux ans sur les visas d’études. Environ 360 000 permis seront accordés en 2024, soit 35 % de moins qu’en 2023.
Cela n’inquiète pas l’UQAC, qui entend poursuivre ses efforts de recrutement.
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
Ghislain Samson, recteur de l’UQAC
« On n’a pas de cible, mais on veut augmenter le nombre d’étudiants internationaux et le nombre d’étudiants de manière globale, explique le recteur Ghislain Samson. On travaille avec des hôteliers de la région pour qu’ils puissent convertir certaines chambres et en faire du logement étudiant. C’est une solution à court et moyen terme. Et on travaille également avec des entrepreneurs pour développer des résidences étudiantes à moyen et long terme. »
Des efforts « gigantesques » sont déployés pour les attirer, les loger et les intégrer, mais aussi « les faire réussir », ajoute Étienne Hébert, son vice-recteur aux études. « Les actions qu’on pose sont très nombreuses, dit-il. On a tendance à sous-estimer les différences culturelles, même avec les Français. Il y a beaucoup d’éducation et d’intégration à faire. »
Il faut aussi accompagner les étudiants québécois et les professeurs dans « l’adaptation à cette nouvelle réalité ».
Donc, la croissance, oui, mais pas à tout prix.
Selon le recteur Ghislain Samson, « ça se passe bien, mais il y a encore des enjeux avec la population parce que le Saguenay–Lac-Saint-Jean n’a pas été habitué à ça dans le passé. De voir débarquer 2000 étudiants qui se retrouvent dans les restos, qui travaillent au centre commercial, c’est assez inusité ! »
En savoir plus
- 13 %
C’est le taux de croissance des étudiants étrangers inscrits au baccalauréat, entre 2022 et 2023, à l’UQAC.
Bureau de coopération interuniversitaire
Cinq idées pour loger les étudiants
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
À Alma, où se trouve le collège d’Alma, le taux d’inoccupation est de 0,3 %.
La crise du logement frappe aussi le Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les étudiants étrangers sont en grand nombre. Plusieurs idées ont été mises en place pour augmenter l’offre de logements. En voici cinq.
Publié à 5h00
![]()
Fouiller les petites annonces… pour les étudiants
À Alma, ville de 30 000 habitants, le cégep fouille les petites annonces sur Kijiji et quadrille le quartier pour dénicher des logements. « Cette année, on a franchi un pas de plus, c’est-à-dire qu’on a fait ça, et on a continué à le faire l’été dernier, pendant que le cégep était fermé », révèle Frédéric Tremblay, conseiller aux communications et au développement institutionnel du collège. « On a gardé une ressource à temps plein pour travailler sur ce dossier-là, uniquement, et pour négocier des partenariats, à gauche et à droite. »
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
Frédéric Tremblay, coordonnateur des communications et du développement institutionnel au collège d’Alma
Construire des résidences
Un projet de résidence étudiante de 40 unités est aussi dans les cartons au collège d’Alma. Cette solution à moyen terme est également explorée par l’Université du Québec à Chicoutimi, qui compte déjà une résidence étudiante de 241 chambres.
Convertir des espaces
Autre idée : convertir des espaces inoccupés en logements. Le collège d’Alma discute avec des résidences pour personnes âgées, pour y loger des étudiants étrangers. « On évalue la situation en temps réel, explique Frédéric Tremblay. On ne veut pas freiner notre développement de ce côté-là. Il y a 250 projets de logements ici à Alma. » Au centre-ville, un promoteur a acquis un tiers du centre commercial, où plusieurs locaux sont vacants, avec l’idée de les transformer en logements. De son côté, l’UQAC collabore avec des hôteliers de Chicoutimi pour loger des étudiants.
Stimuler l’offre
Le cégep de Jonquière compte 450 étudiants étrangers. Pour les loger, il « travaille avec le milieu et les propriétaires de logements pour inventorier les places disponibles et publie une liste pour outiller les étudiants », détaille Sabrina Potvin, coordonnatrice des communications. « Nous stimulons également l’offre en invitant toute personne pouvant offrir une formule d’hébergement à nous le faire savoir, dit-elle. Le cégep est un facilitateur qui accompagne l’étudiant dans sa démarche. »
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
Sabrina Potvin, coordonatrice des communications au cégep de Jonquière
Développer des partenariats
Au cégep de Saint-Félicien, Nathalie Landry, directrice adjointe responsable du recrutement international, a embauché une personne pour s’assurer que tous les étudiants étrangers « allaient avoir un logement qui les attendait », à la rentrée. « On a développé un partenariat avec une ancienne école dans la ville de Dolbeau : il y a deux ailes où logent 24 étudiants, une pour les garçons, l’autre pour les filles, précise-t-elle. On a aussi des appartements étudiants et un réseau de familles d’accueil. » En mars, Mme Landry va recruter une personne pour travailler à temps plein sur ce dossier.
Deux autres articles en cliquant sur le lien.
Dans cet article du JdeM
UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES : RÉINVESTISSEMENT DE PLUS D’UN MILLIARD $ RÉCLAMÉ
Les universités québécoises réclament un réinvestissement d’an moins un milliard $ pour combler le retard du Québec en matière de diplomation universitaire.
«On pense qu’il y a beaucoup de ressources à investir dans la réussite étudiante. On a des retards en terme de taux de diplomation et de persévérance, il y a vraiment un consensus à ce niveau-là», affirme Daniel Jutras, président du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et recteur de l’Université de Montréal.
Le Québec tire toujours de l’arrière comparé à l’Ontario, où 45% des 25-34 ans détiennent au moins un baccalauréat comparé à 36% au Québec.
À l’échelle des pays de l’OCDE, cette proportion est de 40%.
L’écart avec l’Ontario s’est d’ailleurs creusé au fil des ans, étant passé de trois points de pourcentage il y a 25 ans à neuf en 2021, peut-on lire dans le mémoire du BCI remis au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires.
En terme de revenus disponibles, l’écart avec les universités du reste du Canada est toujours évalué à 1,25 milliard $, selon des chiffres qui remontent à 2018-2019.
Un «sous-financement significatif» persiste toujours concernant les ressources informationnelles des établissements, ajoute-t-on.
«Il y a des besoins extrêmement importants en terme de révolution numérique, non seulement dans l’enseignement mais aussi en terme de sécurité, qui vont nécessiter des investissements majeurs», affirme M. Jutras.
Les universités québécoises réclament ainsi un «financement additionnel récurrent» de 1 à 2 milliards $ afin «d’augmenter la capacité des établissements universitaires à innover et à gérer leurs ressources informationnelles».
Est-ce que les entreprises canadiennes ré-investissent assez dans les universités québécoises?
Ce n’est pas aux entreprises de combler le vide laissé par la négligence gouvernementale.
Si on veut privatiser des universités, qu’on le dise, mais de là à pointer du doigt les compagnies d’ici par rapport à ce manque d’investissement, on repassera.
Je ne vis pas au Québec, donc je posais simplement une question. Qui parle de privatiser les universités? En fait les frais de scolarité sont gelés au Québec depuis un certain temps, il y a peut-etre une piste là?
Les frais de scolarité sont p-ê gelés/peu augmenté depuis le printemps érable, mais tous les autres frais ont augmenté drastiquement.
Aussi, les université anglophones reçoivent plus de dons privés de la part de leur alumni. Je crois que l’écart tend à diminuer.