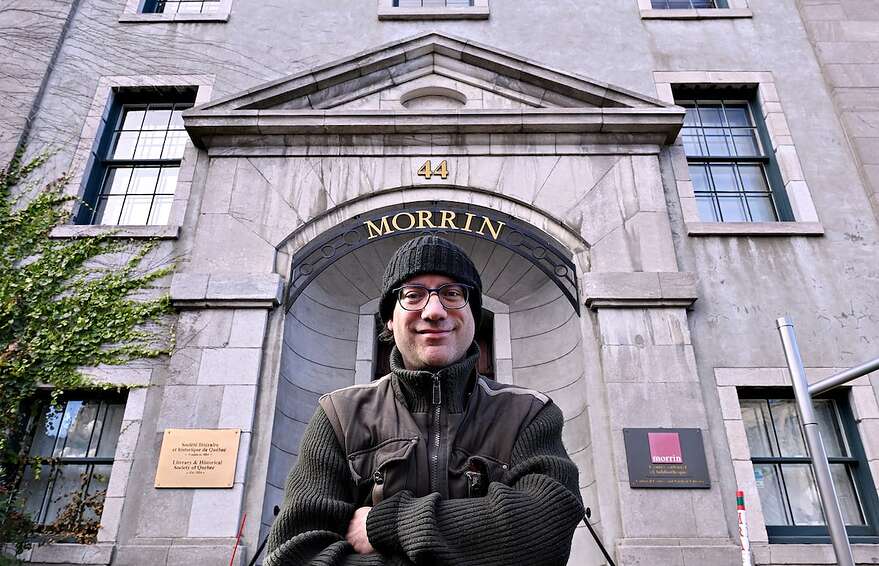Discussion et actualités sur l’art autochtones
L’art autochtone est vaste, ancien et encore trop méconnu, voici un fil pour le mettre en valeur et nous permettre d’en apprécier les beautés et le génie créateur.
Résumé
Les décorations de piquants de porc-épic, une histoire de famille pour Christine Toulouse
Christine Toulouse tient une décoration de piquants de porc-épic.
Photo : Radio-Canada / CBC
Radio-Canada
Publié hier à 21 h 47 HAE
Pour Christine Toulouse, les décorations de piquants de porc-épic sont plus qu’une question d’art.
Elle se souvient qu’elle tenait une tasse de thé lorsque sa mère et sa grand-mère lui ont enseigné pour la première fois comment retirer les piquants d’un porc-épic.
Elles étaient assises sur le porche de la maison de sa mère, dans la Première Nation de Sagamok Anishnawbek, dans le Nord de l’Ontario. Mme Toulouse les observait tandis qu’elles retiraient habilement les piquants sans arracher la peau de l’animal mort.
Ma grand-mère et ma mère, surtout ma mère, étaient très enthousiastes à l’idée de me l’enseigner.
Elle était déjà adulte à ce moment-là. Elle a demandé, de son propre chef, à sa famille d’apprendre comment pratiquer cet art traditionnel autochtone, qui consiste à tisser des piquants de porc-épic à travers de l’écorce de bouleau, au cours de l’été de 2016.
AILLEURS SUR INFO : Doug Ford exige le retour des sacs en papier à la Régie des alcools
À l’époque, elle souffrait de maux de dos chroniques.
Puis, elle a appris que sa mère avait reçu un diagnostic de cancer du côlon.
Elle a décidé de quitter Ottawa, où elle habitait alors, afin de retourner dans sa Première Nation natale et prendre soin de sa mère.
Sa grand-mère, elle, a toujours créé des décorations en piquants de porc-épic. Elle les vendait un peu partout en Amérique du Nord.
Christine Toulouse et sa grand-mère Ida, sur la rive du lac Huron.
Photo : offerte par Christine Toulouse
L’idée d’apprendre est donc venue naturellement.
J’ai décidé que c’était ce dont j’avais vraiment besoin dans ma vie. J’ai dû passer beaucoup de temps à l’intérieur pour m’occuper de ma mère. J’avais besoin de quelque chose qui nourrisse mon âme et me relie à la communauté, explique Mme Toulouse.
Christine Toulouse tire un piquant de porc-épic à travers de l’écorce de bouleau, démontrant l’art traditionnel.
Photo : Radio-Canada / Francis Ferland/CBC
L’art de la décoration de piquants de porc-épic se transmet d’une génération à l’autre depuis des centaines d’années, selon Naomi Recollet. L’archiviste de la Fondation culturelle ojibwée a elle-même appris grâce à sa propre grand-mère, à ses tantes et à ses oncles.
Il y a beaucoup d’efforts collectifs de la part de la communauté pour recueillir les matériaux eux-mêmes, et je pense que c’est l’un des aspects que je préfère.
L’écorce de bouleau est récoltée pendant la saison des fraises. Les piquants sont récoltés tout au long de l’année. Les artistes teignent souvent les piquants de différentes couleurs avant de les broder pour créer différents motifs.
Une boîte décorée de piquants de porc epic faite par la grand-mère de Christine, Ida.
Photo : offerte par Christine Toulouse
Après avoir passé l’été à teindre des piquants, à récolter de l’écorce et à vendre ses premières œuvres, Mme Toulouse est retournée à Ottawa pour trouver du travail. Elle n’a pas rouvert sa boîte de matériel de décoration de piquants de porc-épic pendant six ans.
Pendant cette période, sa mère a subi des traitements de chimiothérapie et des interventions chirurgicales dans sa lutte contre le cancer. Elle est décédée à l’automne 2019.
À lire aussi :
- Une Anishinaabe nord-ontarienne veut transmettre son savoir-faire artisanal
- Une exposition réunit l’artisanat autochtone traditionnel et contemporain à Winnipeg
- Un premier économusée autochtone pour promouvoir l’artisanat innu
Alors que Mme Toulouse faisait le deuil de sa mère, elle a ressorti le matériel stocké dans son placard.
Tout ce qu’elle avait touché, je voulais […] en faire quelque chose de beau et de tangible. Et c’est ce que j’ai fait.
Mme Toulouse explique qu’elle a apppris la décoration de piquants de porc-épic dans un contexte où elle espérait voir sa mère guérir. Puis, c’est devenu un outil de deuil. Ensuite, elle a pu en vivre : elle vend ses œuvres lors d’événements.
Aujourd’hui, elle l’enseigne : elle organise des ateliers communautaires, qui se sont développés grâce à une subvention du Conseil des arts de l’Ontario pour enseigner aux jeunes autochtones.
Mme Toulouse reconnaît que c’est sa grand-mère Ida, décédée l’année dernière, qui lui a donné la confiance nécessaire pour enseigner.
J’ai l’impression que [la décoration de piquants de porc-épic] m’a été donnée pour que je la transmette, et j’ai heureusement reçu ces connaissances de ma famille et de ma grand-mère.
Avec les informations de Wafa El-Rayes de CBC